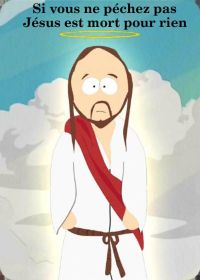Pomme
|
Pomme (јаболко en macédonien - pom en nissard) Être ou ne pas (en) être (une).
AvertissementBien que les religions et les mythologies de toutes sortes soient des œuvres de fiction, elles impactent durablement, non pas seulement les imaginaires des hominines [1], mais aussi leurs comportements car elles sont, par essence, productrices de normes sociales et morales. Lorsqu'elles n'en sont pas les sources, elles en sont les légitimations. Tout autant constitutives de réalité que véritable réalicide pour les hominines qui y croient et/ou les subissent. L'amour divin a bien souvent des allures de parc à bestiaux et d'abattoir à ciel ouvert. Dans les trois monothéismes qui naissent et se développent dans les territoires du sud-est de la Méditerranée au cours des derniers millénaires, il y a la croyance naïve d'une divinité suprême qui crée toutes choses. Elle seule est incréée — bien qu'existante ! — et son monde est un chaos infini, un grand tohu-bohu [2]. De l'hébreu ancien תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ, de tōhū "vide, néant, désert, solitude" et bōhū "vide". Probablement par ennui de vivre dans la solitude, cette divinité se forge un univers tangible, peuplé d'êtres vivants, entièrement soumis à son bon vouloir. Apparaissent les végétaux et les animaux. Elle instaure que l'hominine est l'animal auquel les autres doivent obéir. Unique de son espèce, l'hominine se nomme Adam. Né trop tôt pour connaître les anti-dépresseurs, il ne peut rester seul sans prendre le risque de se perdre dans ses pensées. Ève est créée pour lui tenir compagnie. Trop égocentrique, Adam ne comble pas la curiosité d'Ève. Enfreignant l'interdiction dictée par la divinité, elle propose à Adam de manger avec elle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent lui a dit que cela serait une bonne chose. Plutôt que manger ce serpent pour le faire taire définitivement, les deux hominines décident de passer à l'acte. En colère pour cette désobéissance, l'entité divine chasse ses hominines de leur "paradis" où la nourriture ne manque pas et les condamne à vivre durement du travail de la terre. Ainsi que toute leur descendance. Dieu est très exigeant en amour. Selon ce scénario mythologique, cet épisode marque le début de la réalité historique des hominines et de leurs civilisations. La traduction en latin des textes moïsiens et christiens sur cette pré-histoire mythologique, écrits en hébreu, en araméen et en grec, présente quelques difficultés. Quel est donc le fruit de cet arbre dit de la connaissance du bien et du mal ? Les avis divergent et parfois il est dit qu'il s'agit d'une figue, d'une poire, d'une grenade ou d'une grappe de raisin. Tout se joue autour de la traduction du mot malum. Le latin tardif ne fait plus la distinction entre les voyelles longues et courtes, ainsi il y a confusion entre mālum et mălum. Le premier, emprunté au grec parlé dans le sud de la péninsule italique, désigne les fruits arrondis [3] alors que le second est d'origine latine avec le sens de mal ou mauvais [4]. L'un se retrouve en français dans melon [5] ou camomille [6] et l'autre dans tous les dérivés à partir de la racine mal, comme par exemple malheur, maladie ou malhonnête. En latin, poma désigne les fruits à noyaux ou à pépins. La datation du glissement de sens entre malum et pomme n'est pas établie mais il intervient dans le contexte des pratiques linguistiques qui se rattachent au latin du nord de l'empire romain. Cette possibilité de "jeu de mot" ne fonctionne pas dans les langues d'écriture des plus anciens textes de cette mythologie. D'après les traductions du mot français pomme dans les différentes langues latine d'Europe, il semble que celles du nord adoptent des dérivés de poma alors que les autres conservent des dérivés de malum. Par exemple, le normand poume et l'occitan poma, ou l'italien et le corse mela. Dans l'espace germanique l'étymon n'est pas le même et donne apfel en allemand et apple en anglais. Une racine qui se retrouve aussi dans les langues slaves, via аблъко, prononcez /ablŭko/, qui a le sens de pomme. Le latin abellāna désigne une noisette. Un fruit à noyaux et de forme arrondie. Vestige de cette racine latine, le dictionnaire de l'Académie française rapporte qu'une aveline est une variété de grosse noisette, et l'avelinier est l'arbrisseau qui les porte. [7]. Au XIème siècle après leur messie, les récits légendaires christiens autour du roi Arthur et de sa quête du Graal [8] conservent le sens de "pomme" de l'étymon commun aux langues germaniques, celtiques ou italiques. L'île d'Avallon, où le roi Arthur part en convalescence et où son épée magique Excalibur est forgée, est désignée comme l'île aux pommes. Pendant des siècles, les représentations artistiques de ce fruit défendu oscillent entre raisin, pomme et vigne, et il est à noter que Adam et Ève ont généralement une feuille de vigne pour cacher leur sexe. Les pratiques linguistiques francophones les plus anciennes utilisent pome ou pume pour désigner le fruit du pommier. [9] Le sens générique de fruit est encore présent en français moderne dans pomologie qui est la science des fruits ou dans les locutions pomme de pin, pomme de terre ou le désuet pomme d'amour qui désigne la tomate [10]. L'aspect arrondi est attesté dans les locutions pomme d'arrosoir ou de douche, dans le pommeau d'une canne ou d'une épée. [11] Les symboliques et/ou les conséquences parmi les sociétés christiennes de ce mythe fondateur sont de trois ordres. Spéciste, sexiste et pommiste. Cette hiérarchisation dicte que les hominines sont une espèce qui règne sur les autres, que l'élément femelle de ce duo primordial est responsable de l'expulsion du paradis, et que la pomme est le symbole absolu du malheur des hominines. Au cours des siècles, des hominines femelles ont fait entendre leurs voix pour protester contre les symboles et les conséquences d'un tel imaginaire misogyne. La critique antispéciste s'en nourrit. Mais les seules à ne pas être entendues sont les première concernées, les pommes elles-même. Culpabilisées à l'extrême, elles se désespèrent. Extrait d'une interview exclusive protivophile de l'une d'elles, rendue publique en 2022 :
RéhabilitationMême si cela est très-très-très marginal, et donc mentionné nulle-part, la protivophilie relève l'existence d'une approche dite abeliste ou abelitioniste. Ne pas confondre avec appeliste ou abolitionniste. L'idée est de porter la critique du sort fait aux pommes. À toutes les pommes. Leur principal porte-parole est le charismatique Jean-Claude Van Damme qui ose, en 2003, annoncer publiquement que "Moi, Adam et Eve, j'y crois plus tu vois, parce que je suis pas un idiot : la pomme ça peut pas être mauvais, c'est plein de pectine..." [13] La lutte est lancée. Et elle sera longue. Il faut en finir avec les blagues déplacées, les allusions sulfureuses et les insultes permanentes. Guillaume Tell [14] n'est qu'un infâme pourfendeur de pomme et Isaac Newton [15] s'accapare honteusement les travaux qui concluent à l'existence de la gravité terrestre. L'un transperce avec ses flèches, l'autre regarde une pomme tomber. Par humilité et délicatesse d'esprit, JCVD n'admet jamais qu'il est en quelque sorte dans la continuité de l'œuvre du musicien et compositeur Ludwig van Bethoven et son fameux "Pom Pom Pom Pom". Botaniquefaux-fruit ArtistiquePhilosophiqueNotes |